

« J’ai ressenti…»
J’ai ressenti une émotion artistique en peignant des aquarelles.
La difficulté de l’aquarelle en rebute plus d’un.
Sur le plan technique, doivent s’acquérir de nombreuses compétences, et notamment dans la composition
des couleurs (« synthèse additive »), et le respect des lois du déplacemrnt de l’eau sur une surface plus ou
moins perméable.
Des compétences nécessaires, mais non suffisantes.
La « valeur ajoutée » s’appelle au hasard, chance, ou inspiration (souvenons-nous du mot d’Einstein :
« 5% d’inspitation pour 95% de transpiration »).
Un « je-ne-sais-quoi » enfin, dont résulte l’oeuvre fidèle, juste, et pertinente.
J’ai bien souvent gribouillé des aquarelles, en m’efforçant de respecter les leçons apprises « par cœur » :
esquisse au crayon des lignes de fuite, et de force, apport d’eau, masquage, puis couleurs, retrait du
surplus, séchage naturel, ou artificiel, puis, à nouveau re-mouillage, re-couleur, etc…
La plupart du temps je n’atteignais qu’un état de satisfaction tout juste moyen.
Et puis, parfois, je ressentai une vague de jubilation, l’oubli du doute, et de ce que le travail suppose
d’efforts.
Et (surtout), je lisais de la complicité dans le regard de mon juge, qu’il soit « qualifié » ou « profane ».
MC,
le 3 février 2025
Oct 2024
(Sur la vague des sentiments)
Confusion des sentiments
Tel un rouleau écumant,
la colère m’emporte.
Ai-je perdu la face ? Est-ce la jalousie ?
Ou alors un désir que je n’ose avouer…
J’ai honte de m’emporter.
Mais qui a commencé ?
Elle, me donnant à croire, et en me provoquant ?
Ou bien mon imagination ?
J’en ai bien peur : le constat est amer :
je suis sentimental pour deux…
Allez mieux vaut en rire !
le 2 février 2024
Le Petit Chaperon rouge, revu, corrigé, censuré, et inclusif
Mauvais « genre »
Je constate qu’au jour d’aujourd’hui, Il n’est plus de conte anodin
Tout devient « fait de société »...
Le loup du conte de Perrault est passible de la cour d’assises, non pour crime de sang aggravé, mais pour fornication pédophile...
Nous sommes conviés à son lynchage.
(Rien de nouveau sous le soleil ! Du temps de Perrault, déjà l’échafaud suivait la cabale)
« L’enquête est en cours » parait-il... Un « quartier défavorisé » ?...
Une « famille monoparentale » ?
Et cetera, et cetera...
Mais voyons !
Le loup n’est pas une canaille, juste une bête affamée,
et sa proie, du destin, victime...
La morale « primitive » du conte, je la prends au premier degré.
Principe de réalité oblige. Gardons-nous des « bons sentiments » !
Avec Pascal, je ne crois pasque nous devons changer le monde, avant de nous changer nous-même.
2018
Maman ! ?
Je ne me déroberai pas, même si (te) parler (de toi) contient une telle charge émotive qu’il me parait presque indélicat de le faire devant des presque étrangers…
Pourquoi tant de pudeurs ?
Une mère, c’est la chose la plus commune qui soit : chacun de nous en a une.
Oui, mais précisément : une, et une seule…
Et quand chacun parle d’elle c’est à elle qu’il parle…
Avec respect, de préférence.
Avec nostalgie, si elle a disparu. Avec emphase, si on ne l’a pas connue.
Avec colère, avec tendresse, avec tristesse, avec jalousie…mais toujours avec sentiment…
Quand tu m’as quitté, c’était bien trop tôt.
Quand tu veillais, dans mon lit d’enfant, sur ma santé chancelante, je ne mesurais pas ma chance.
Quand j’ai su dire merci, les malentendus se sont chargés de m’en dissuader.
Et puis, je suis passé en d’autres mains, et j’ai oublié.
Tu as toujours été un mystère.
Ce que tu m’as transmis, je suis incapable d’en retrouver la liste.
Si je devais te remercier, par où commencer ?
Nos griefs, nos ressentiments sont tellement plus tangibles que l’impalpable dette de reconnaissance…
Le 29 septembre 2020
- J’écris depuis que j’ai appris,
et, depuis, je continue, pour m’entrainer, et si j’arrête, je désapprends.
- J’écris parce qu’il le faut bien…
pour des raisons alimentaires.
- J’écris mon nom, mon prénom, et ma date de naissance, etc…
Pour la 3500ème fois…
- J’écris aussi quand ça me chante,
comme je chante, comme je siffle, comme les oiseaux, comme les Italiens…
- J’écris pour être lu.
J’ai encore des illusions…
- J’écris pour mieux le dire…
« C’était notre première rencontre à l’atelier d’écriture, nous arrivâmes masqués… »
En deux paragraphes, réalistes ou fictifs, exprimez votre ressenti face à cette situation inédite.
- Enfant spontané, et révolté :
Vous voulez connaitre mon ressenti…
Le voilà, en quelques mots, bien sentis
Ce ressenti, c’est du ressentiment,
ce sentiment c’est la colère.
La colère m’aveugle,
comme la buée sur mes lunettes, à cause du masque…
Je suis à cran,
à cran de sureté,
bien sûr, puisque c’est pour mon bien !…
Etc., etc…
- Enfant studieux, et docile :
Le masque sur la scène de la comédie grecque antique,
ou dans le théâtre ^traditionnel japonais,
comme c’est émouvant !
La distanciation ?
Une pratique devenue vitale, bien avant la pandémie, depuis que le « rentre-dedans » a été
élevé au rang des beaux-arts…
J’ai personnellement pratiqué le karaté, et je m’en félicite : c’est une discipline où garder la
distance est vital : si tu touches, tu risques de tuer…
La solution hydro alcoolique ?
Une étape décisive dans la lente conquête de l’hygiène publique, elle-même contribution essentielle
au progrès de l’humanité ?
Etc., etc…
MC, le 26/09/2021
Le temps de vivre
Oublier le temps est une expérience délicieuse : soit par inattention, ou dispersion, ou, au contraire, lorsque je suis en proie à une passion dévorante…
Mais le temps, me direz-vous, lui, ne m’oublie pas, et il se venge : pendant que tu perdais ton temps, tu as tout simplement vieilli.
Il y a pire : j’ai peut-être « perdu du pouvoir d’achat », ou laissé passer une opportunité, comme on dit.
Je ne parle même pas du temps que je pourrais consacrer à rendre celui d’autrui plus tolérable : autrui, c’est à dire un parent en fin de vie, un mendiant à Pékin, un ami dans le malheur…
Bien sûr, nous utilisons une échelle de mesure du temps objectif, et nous usons de critères de valeur subjectifs pour apprécier notre temps « utile », comme s’il s’agissait d’une réalité somme toute indépendante, et extérieure.
Mais considérons aussi que la vie nourrit le temps, tout comme le temps alimente la vie.
Le temps qui passe abolit-il notre vie ?
Et si, au contraire, il l’accomplissait.
Tant il est vrai que le temps n’est qu’une contrepartie.
2022
Le printemps des poètes (en herbe…).
Qu’est-ce que j’vais prendre lundi ! …
Ma compo est ratée.
J’ai copié su l’voisin.
Ça m’fera 5 points d’moins.
Y vont se moquer d’moi.
J’vais passer sous la table.
L’aurait pas pu prévenir,
mettre 2 tapis de sol,
réceptionner mon saut,
et pas m’laisser tomber !
L’poignet gauche a tout pris…
1 mois de plâtre au moins !
Ah les filles, ces chipies !
Je l’ai pas inventé.
Ou j’me suis trompé d’heure ;
Ou j’ai compris d’travers…
Et pourtant c’était clair…
P’t’être bien qu’elle est malade…
Fleurs de givre, 1956
Je n’ai pas « été à l’école » …Je suis né, et j’ai grandi dedans.
En février 1956, mes parents enseignaient tous les deux dans un « groupe scolaire » de six classes. L’année était rythmée par l’alternance rentrée, et vacances, et dans cet intervalle, balançait entre deux des trois blocs du bâtiment : le « logement », au centre, et une aile (celle « des garçons », bien sûr !).
Je n’avais qu’un couloir, et une porte à franchir, pour troquer le monde « privé », contre celui « du travail ». En cela, je pouvais comprendre mes camarades, fils de « petits » paysans, pour la plupart.
Je vivais dans le « devoir », et « les » devoirs, un univers voué à la promotion du savoir, et à « l’élévation », au sens chrétien (mes parents étaient des laïcs chrétiens).
Concrètement, je me devais d’avoir « une » ambition, et de « tenir mon rang », le premier, de préférence…
Le programme consistait, notamment, à bien penser, agir, et parler correctement, à la maison, et à réussir ensuite le « sans-faute », sous la dictée de mon père, en classe.
Et ça marchait : je conjuguais l’apparence de l’enfant (presque) parfait, et la réalité de premier de la classe.
Cet hiver-là, le froid perdurait, la neige tombait, et tombait encore, et submergeait le pays limousin.
Les cours d’eau gelaient. D’abord mes ruisseaux à écrevisses, puis les rivières à truite, et enfin, et surtout, sa majesté la Gartempe, aux eaux profondes, peuplée de tanches, de chevesnes, et de brochets, ses courbes gracieuses mordant les falaises de granit.
Je compris, à l’accumulation de certains signes, qu’il allait se produire de grandes choses : le quotidien était perturbé, et le pouvoir des adultes moins assuré…
L’effectif des élèves maigrissait : les parents renonçaient, les uns après les autres, à laisser trainer leurs gosses dehors.
Je pensais que mon père serait contrarié : au contraire, il paraissait s’accommoder de devoir improviser, tous les jours, et parfois avec le sourire…
En haut lieu (comprendre : l’Inspection Académique), il fut décidé de lâcher du lest.
Mon père nous annonça que les cours étaient « suspendus » : plus de dictée, ni de devoirs à la maison, plus de récréation dans le froid, mais, à la place, des séances de jeux, et des fims, dans une salle bien chauffée (la réserve d’anthracite, à la cave, permettait de tenir).
Grâce au projecteur du « cinéma scolaire », le spectacle était quotidien.
Pas question, pour autant, de rester confinés, avec ce grand soleil : à nous les derniers chemins praticables, et les routes asphaltées, à la disposition des seuls piétons.
Nous faisions le tour des étangs gelés (d’autres s’aventuraient à les traverser à pied), affrontant les congères, et sans raquettes.
Tiens ! L’été d’avant, par ici, j’avais surpris à temps un aspic, dormant sur le tas de pierre, au bout du buisson de genets en fleur…
Papa « se lâchait » : le contexte aidant, il se mettait à évoquer les cruels hivers silésiens, « sa » guerre en Pologne, le travail (forcé) au laminoir - la chaleur intense, le bruit, la poussière, les efforts musculaires - et, dehors, le froid glacial, et pas grand-chose à manger…L’adversité…
Papa « s’humanisait » à vue d’œil. Nous nous rapprochions, complices.
Les femmes de la maisonnée n’étaient pas conviées à partager nos aventures.
Les jours allongeaient. J’avais sans doute déjà vu des fleurs de givre, sur les carreaux de cette fenêtre.
Mais ce matin-là, je m’immobilisais, et j’observais longuement leurs arabesques parfaites.
J’étais fasciné par un spectacle aux lois mystérieuses, qui me ravissait.
Le dessin de ces humbles cristaux était le messager d’un monde désirable…
Saint Sulpice-les-Feuilles
« Madeleine ? »
Cette voix, c’était celle de ma grand-mère Blanche.
Blanche, fille de Madeleine, mon arrière-grand-mère, par conséquent…
Du haut de l’escalier, de l’émotion dans la voix, Blanche interpellait Madeleine, qui venait de s’introduire dans la cuisine.
Une scène familière commençait alors : le rituel de la vaisselle.
Mon grand-père s’éclipsait, abandonnant le terrain aux deux femmes.
Deux complices, qui, pour rien au monde, ne tenaient à l’associer à leurs échanges, ce qu’il ne savait que trop…Un faux-bourdon n’a rien à faire dans la ruche !
La corvée de vaisselle était prétexte à resserrer les liens.
Mère et fille entretenaient un amour fusionnel : depuis quarante ans, elles vivaient à trente mètres de distance l’une de l’autre, dans la même rue, qu’elles n’avaient quasiment jamais quittée, ignorant tant le mot « vacances » que le mot « voyages ».
Voici donc pour « Madeleine » avec un M majuscule.
Mon histoire comporte aussi une version avec la minuscule.
Je peux, à la rigueur, l’associer à Marcel Proust (au passage, mentionnons d’ailleurs que mon grand-père avait pour prénom Marcel…).
J’avais droit, moi aussi, de faire trempette dans une infusion (servie dans la tasse d’un « service » en authentique « Limoges »).
Cela se déroulait, mettons, en fin d’après-midi, après une belle partie de pêche à la ligne, ou, plus tard en saison, une cueillette de champignons.
Je suis sûr qu’il y avait un gâteau (une madeleine, pourquoi pas ?).
Mais surtout un parfum.
L’arôme suave, et fort, de l’infusion de menthe (du jardin).
Jamais de tilleul (je connaissais) ou de thé (je ne connaissais pas encore) : je suis formel !
Quel bonheur !
Mais pourquoi faire « tout un plat » d’un simple gâteau, si menu, et bien tourné soit-il ?
Le 25 septembre 2023
Timshel
Dans son roman « A l’Est d’Eden », John Steinbeck met en exergue un mot hébraïque, tiré de la Bible, dont il ponctue les instants décisifs : « Timshel ».
Traduction approchée : « Tu le peux ! »
Par ce mot, YAHVEH répond aux propos défaitistes trahissant les doutes, le découragement, et le manque de confiance en l’avenir, de son peuple.
Cette expression vaut encouragement : elle libère l’homme du poids excessif de la destinée, et engage sa responsabilité personnelle.
Dit autrement : notre vie est une page blanche.
Lorsque je décide d’écrire un nouveau chapitre, aux sens propre, ou figuré, je dispose pour l’avenir : je m’engage.
Mais cette liberté a une contrepartie : tout engagement comporte un prix.
La parole pèse. Mais le silence, plus encore…
A la fin du roman de Steinbeck, Cal assiste aux derniers moments de son père, sur son lit de mort.
Cal attend un mot, qui lui a été refusé, jusqu’à présent, et qui signifierait pardon, bénédiction, confiance et amour.
Et son père, dans un dernier souffle, prononce « Timshel ».
« Mon fils, tu le peux ».
08/11/23
La peur ou l’enchantement de l’étranger…
Commentez…
Ma première expérience professionnelle durable s’est déroulée loin du pays natal : j’enseignais l’Histoire et la Géographie dans un Lycée de l’Afrique de l’ouest…
J’étais aux premières loges pour connaitre ces deux sentiments, intimement mêlés : la peur, et l’enchantement…
Ce que j’en ai retenu : il y a deux manières d’être étranger
De même que le mot comporte deux acceptions.
L’une relève de l’inné (passif), l’autres de l’acquis (actif).
Une dualité que l’on retrouve dans le mot lui-même, tour à tour nom, ou adjectif, qualité intrinsèque de la personne (son identité), ou simple attribut (ses qualités).
Je suis « un » étranger : c’est une situation subie, un statut. Cela me rattache au passé, à mon histoire, à mon héritage. J’en suis le dépositaire. Cette réalité extérieure, ne dépend pas de moi.
Ce qui dépend de moi, par contre, c’est de me comporter, ou non, « en étranger » : comme un original, un être singulier, un anticonformiste, une victime, etc…
Les deux sont juxtaposables : l’étranger au pays (étranger « statutaire ») peut souhaiter se comporter « en étranger » dans son milieu de vie, en refusant toute acculturation.
C’est lui qui décide.
Il ne sert à rien d’invoquer le racisme, l’incompréhension, l’adversité, comme des excuses.
Cela existe, certes, mais ne dépend pas de moi, je n’ai aucune chance de les abolir : je dois donc faire avec, et porter mon effort ailleurs.
Lutter contre mon incuriosité, et ma paresse intellectuelle.
Acquérir de nouvelles compétences.
Apprendre. Observer. Passer les étapes d’initiation, et d’apprentissage. Savoir reconnaitre les systèmes de pensée, les conventions sociales…
Eveiller l’étranger qui sommeille en moi, et en faire un allié.
mai 2023
Eiréné (la paix)…
Un pilote aux commandes. Un cockpit, noyé de lumière.
Le bruit, et les vibrations parviennent un instant à distraire l’homme de ses pensées.
Puis il reprend son monologue intérieur ; « je suis un professionnel surentrainé. Je sais résister au stress. Je l’ai prouvé : j’ai été sélectionné parmi des centaines de concurrents… »
C’est vrai : il a été choisi pour réaliser l’action la plus démesurée jamais confiée à un pilote de bombardier…
Alors, il se concentre. Une fraction de seconde, même, il n’entend plus rien, seulement un silence de mort.
Puis il revient à la réalité, totalement lucide.
Le compte à rebours va commencer.
Le soleil est au zénith.
Au sol, quelques milliers de pieds sous l’avion, des myriades, des millions d’yeux captent le même soleil.
« Three, two, one… ».
Il se recueille un instant. Il prie, peut-être.
« Suis-je le bourreau, ou un super patriote ?... »
Dix soleils. Mille soleils.
Derrière ses lunettes teintées, il ressent un picotement.
Il met les gaz à fonds.
Le panache éblouissant s’élève dans le ciel, derrière l’avion.
Un silence de mort étreint la ville, en partant du point d’impact.
Il succède à la vague du feu, et des radiations mortelles…
le 1er juin 2024 Nouvelle
« Allo, allo, James ! Quelles nouvelles ? »
Rien de ce qui suit ne doit être pris au premier, ni même au second degré.
Tout y est relatif, mais, en même temps, authentique : ce n’est pas une fiction.
Le réel est mon seul maître !
Plutôt que d’une nouvelle, objet de la commande, peut-être alors s’agit-il d’une fable ?
A vous d’en juger !
Vous êtes sans doute française/français, de passeport, sinon de naissance…
Et, par voie de conséquence, républicain-e, donc laïc…
Alors ? là, je m’interromps un instant, pour déplorer les « limites de genre » du français académique.
Existe-t-il, en effet, un féminin pour l’adjectif « laïc » ?
Que nenni ! « LATQUE » (épeler !), dites-vous ? Hélas non !
« Laîque » existe, en effet, mais il s’agit d’un substantif, doté d’un autre sens…
Où nous constatons que le genre « neutre », en français, « ça dépanne ». Il a « anticipé » : du « transgenre » avant l’heure…
Je reprends.
Inimaginable, et pourtant bien réel !...
Non seulement cette monarchie compta plusieurs femmes, mais celles-ci se situent tout en haut du tableau d’honneur…
Or, dans ce même royaume, l’usage depuis cinq siècles veut que le roi, et donc la reine - les femmes étant des hommes comme les autres - une fois couronné, soit désigné, ipso facto, chef de l’église nationale.
Le chef - fût-il femme - domine d’une tête (couronnée) le plus haut gradé dans l’ordre ecclésiastique, archevêque de son état : nécessairement un homme…
Il faut préciser que cette étrange contrée, quand elle vira son « papisme », se garda d’imiter l’égalité des chances, et la promotion de la femme pratiquée par les églises protestantes, ou réformées : pas plus les Luthériens - qui acceptèrent les femmes parmi leurs pasteurs - que les partisans de Calvin, si nombreux parmi ces fieffés Ecossais…
Ledit pays, pensez-vous, se situe outre Manche.
C’est presque ça, si nous négligeons les îles Anglo-Normandes, ainsi qu’une poussière de territoires insulaires, ou côtiers, semés au quatre coins du globe…
Et son nom, au juste ?
« Royaume Uni d’Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande (du Nord) ».
N’ayons garde d’oublier l’île de Man, propriété personnelle du souverain…
Et quelles sont les frontières entre « Union Jack » et « Union » (tout court)?
Au grand désespoir du géographe, leurs contours sont « alternatifs » : tantôt postées à Paris (Gare du Nord, direction Londres par l’Eurostar), quand elles ne courent pas la (verte) campagne, entre Belfast, et Dublin, ou alors les eaux fraiches, et agitées, de la Mer d’Irlande…
« Pragmatisme », ou « bricolage » empirique (dixit un esprit cartésien)…
Un bricolage qui a tenu bon : aussi longtemps que les «sujets » - fussent-ils fieffés Ecossais, fourbes Gallois, ou encore, ces énervés d’Irlandais - acceptèrent de payer le prix du sang, au côté des Anglais. Résultat (ou coïncidence ?) : le pays ignora toute occupation étrangère de son insularité depuis 1066…
Et lorsque la patrie commune, alors toute puissante, fut érigée en Empire, la couronne impériale échut à une dame : Victoria.
Au sud du « Channel », ce ne fut jamais le cas : pas de reine, ni d’impératrice, en France, au sens de « souveraines ». Seulement des « épouses de », au mieux, des régentes…
Le reste de l’Europe « continentale » sauva tout de même la mise : il connut de « vraies » reines, et même de « grandes » impératrices.
Laissons de côté la conduite à gauche !
Abordons plutôt cette étrangeté : un ministre des Finances (« l’Echiquier ») tolérant la confusion entre le budget d’entretien de la famille royale, et celui de l’Etat, le tout adossé à une seule, et même comptabilité : un pur scandale pour tout Inspecteur des Finances parisien, formaté à la stricte séparation des genres Privé et Public (en théorie…).
J’étais loin encore de me pencher sur les finances publiques, lorsque, dans l’enfance, je fus initié à bien des mystères « britanniques »…
Depuis l’instant où je surprenais maman feuilletant avec jubilation « son » Paris-Match, s’attardant sur les photos de Cour, et m’apprenant, au passage, le nom de tel prince, telle princesse, roi, ou reine, et, notamment, Elisabeth II.
Il faut dire que maman était un peu royaliste, par son père…
En outre, elle croyait aux « signes du ciel » (aujourd’hui, on évoque plutôt « l’alignement des planètes »…).
Or, les années de naissance de « ses » deux ainés étaient les mêmes que celles des ainés de la Reine, et dans le même ordre : garçon, puis fille…
A mon insu, donc, la vie de la famille Windsor « impactait », et me travaillait, quand bien même affectais-je la plus totale indifférence pour leur faits et gestes…
Jusqu’au jour récent où, feuilletant une proposition de « voyage d’exception » à Londres, en « compagnie de Stéphane Bern », je craquais…
Mes enfants persiflaient ; « Nous ne savions pas que tu fréquentais les « people »… ». Ce à quoi je répondais, glacial : « Moi non plus… ».
Monsieur Bern « assura » avec brio, enchaînant les étapes d’un « rallye » parmi les hauts lieux de l’histoire institutionnelle, religieuse, militaire, et politique, et les résidences de trois reines illustres - les deux Elisabeth (Tudor, et Windsor ), et Victoria - le tout entrecoupé de spectacles costumés, et de conférences, tout en promouvant son dernier, et 56 -ème, opus, copublié chez Plon et Paris-Match (« La reine qui aimait la France », 2023).
Je feuillette son « livre d’images », puis je parcours à pied les forteresses, palais, églises, et appartements princiers, méditant sur le « métier » de roi-reine, les pièges de la célébrité, la solitude parmi les foules, le sacrifice de l’intimité, la confusion des genres, des rôles, voire des sentiments, publics, et privés…
Parcourant ensuite le « guide-souvenir officiel » de St Paul’s Cathedral (œuvre de Christopher Wren, authentique génie de l’histoire britannique, qui en compta tellement…), mon regard s’arrêts sur une photo.
Le cliché date du 29 juillet 1981. Il montre Diana Spencer, et Charles, prince de Galles, descendant les marches de la cathédrale, après leur mariage.
Un évènement « énorme » : 35 000 invités, 750 millions de téléspectateurs…
Mais un lieu « décalé », en regard de la tradition : réservé aux hommages de la nation à ses héros, aux actions de grâce, aux jubilés royaux, et aux cérémonies funèbres officielles.
« Le Palais », consulté pour avis, sinon pour accord, ainsi que l’archevêque de Cantorbéry, avaient émis un avis très réservé, recommandant plutôt Westminster…Finalement, ils « s’inclinèrent ».
Orgueil ? Défi ? En un mot, hubris ?
En tout cas, victoire sans appel des logiques du spectacle, et du marché : un évènement survendu par les tabloïds, et les médias de divertissement du monde entier.
Et j’en viens, naturellement, à une autre image, en contrepoint : celle du dénouement.
Sous la bruine froide, et tenace, de janvier, masquant, côté parc, les pièces d’eau, et les silhouettes dépenaillées des arbres, je me hâte, le long de la façade de Kensington.
Ce palais, je n’en n’ai pas aimé la visite, sans doute trop rapide : intérieurs mornes, froids, et mal meublés…
Je me hâte de rejoindre la caravane, que j’ai perdue de vue, tout en boitillant, ralenti par un début de claquage d’une cheville, pour cause de chaussures trop légères…
Retour au calme, et au repos : j’ai devant moi la photo de la même façade, du même château. Elle est vivement éclairée par un beau soleil de fin d’été, et assaillie par un tsunami multicolore de bouquets de fleurs, de couronnes, d’ours en peluche…
C’était le 6 septembre 1997.
Des millions de Londoniens, de Britanniques, d’étrangers, avaient suivi, parfois sur des kilomètres, le cortège funèbre, et tenaient à honorer les lieux de vie de Lady Di, « princesse du peuple ».
Martyre, donc, Diana ! « Forcément » martyre. Mais victime de qui, de quoi ?
Du « système », du « patriarcat », des intrigues de Cour, des paparazzi ?...
Regardons les choses en face.
La relation du sujet au prince (à la princesse), ou celle du citoyen au dirigeant élu, voilà deux modalités du même « contrat de gouvernance » innommé, qui structure l’ensemble du corps politique.
Ce contrat-là assure l’échange entre la délégation d’autorité remontant de la base, contre une garantie de protection, du type paratonnerre, en sens contraire.
Sur les bords des mers de Chine, cela s’appelait « le mandat du Ciel » : l’empereur délaissant l’intérêt supérieur de ses sujets (la loi du Ciel), perdait sa légitimité, et était voué à l’effacement, d’une manière ou d’une autre. Le successeur « remettait les pendules à l’heure ». Le peuple tenait alors sa vengeance, tout en récupérant son capital d’espoir en des jours meilleurs.
Que ce soit à Londres, ou à Paris, derrière un vocabulaire, et une grammaire différents, la même logique est à l’œuvre : ce que nous nommons « démocratie » repose sur l’éventualité d’un sacrifice symbolique : celui du dirigeant qui déplait.
Le dégagisme électoral s’est révélé à l’usage bien plus économique que l’entretien, à vie, d’un bourreau prêt, sur demande, à décapiter le « tyran » : Charles, à Londres, précédant Louis, à Paris…
Quant au fardeau des gens d’en bas , il est équilibré par la charge des responsabilités suprêmes, le poids de la couronne, la crainte du complot, de la chute, ou du désamour…
Cela ne vous rappelle rien ? La Bible, peut-être ? Le « bouc émissaire » ? Non ?
« Nous » avons peut-être insuffisamment aimé Diana Spencer, oubliant au passage de la mettre en garde contre ces lois d’airain, étrangères à toute « bienveillance ».
Ou trop mal aimé : prisonniers, comme elle, du conte de fées, nous avons entretenu une chimère.
Ou alors, aimé plus que de raison, et trop tard, pleurant sur son destin comme si nous étions pour quelque chose dans les circonstance de sa fin tragique…
Je cite le sociologue Gérald Bronner : « la fonction essentielle du leader est d’incarner l’image flatteuse de lui-même que le peuple se prête, au mieux, ou, au pire, de prêter son corps, physique, et mystique, au geste sacrificiel qui s’impose, au nom de l’échec collectif ».
Dans mon propos liminaire, je me demandais (et vous invitais à vérifier) si mon modeste opus méritais le nom de « nouvelle ».
Littérairement, je ne sais…
Mais, en tout cas, j’ai personnellement fait une découverte, à l’issue d’un raisonnement serré, dont je m’étonne moi-même de la profondeur, et de la pertinence…
Bonne, ou mauvaise, c’est une « nouvelle ».
Et, à mon avis, elle méritait de vous être contée.
2019 Nouvelle
Le Pont de l’Amitié Navruz
Nous parcourons le sud-est de l’Ouzbékistan, en compagnie, aujourd’hui, de notre guide, Rustam.
Nous avons quitté la ville de Termez, en direction de la frontière Tadjik, sur la rive nord du fleuve Amou Daria. Nous avons rendez-vous avec le « Pont de l’Amitié Afghanistan - Ouzbékistan »...
A Termez, nous sommes hébergés dans un ancien cantonnement de soldats allemands : un des éléments du dispositif de la « Coalition en Afghanistan ».
Le décor urbain, à l’alentour, renvoie l’image figée d’un film vieux de 35 ans : dans le parc d’attraction, une grande roue aux peintures défraichies, plus loin, un marché couvert fatigué, le décor stalinien d’avenues trop vastes, bordées de mûriers blancs, et l’improbable mélange de cubes de béton, et de maisons basses, en torchis, et en brique...
Derrière les rideaux des peupliers s’étale l’Amou Daria.
En gagnant la plaine, le fleuve s’est assagi, après le mélange des torrents furieux, la Vakhch, et la Piantj, grossies par les pluies diluviennes, et la fonte des neiges de l’Hindou Kouch, et du Pamir.
Des corolles blanches de tulipes sauvages égayent les terrasses de galets, et de sable, entre saulaies, et roselières.
Nous n’irons pas plus loin : la route est barrée, et l’accès interdit.
A bonne distance, estompées par la brume de chaleur, et la végétation, se profilent les haubans du pont suspendu. Là-bas, au sud du fleuve, côté afghan, des tours de stockage d’hydrocarbures brillent comme des sous neufs : cette région du pays est calme depuis quelques années... Une exception, et un miracle !
C’est ici que le drame a commencé, la nuit de Noël 1979.
En Asie, la guerre avait reculé partout : les derniers combats entre Vietnamiens et Khmers rouges avaient cessé. 270 millions de Soviétiques aspiraient au bonheur promis par la doctrine officielle...
A Kaboul, quelques mois auparavant, un conflit avait éclaté au sein du parti communiste, alors à la tête d’un pays en paix depuis une génération. La faction opposée à l’alignement sur Moscou l’avait finalement emporté, sous la direction d’Hafizullah Amin.
Mais de là à imaginer la suite...
A 3 h du matin, la nuit de Noël, les premières unités motorisées de l’Armée Rouge franchissaient le pont.
Au même moment, deux divisions de l'armée de l'air sautaient sur Shinband, dans l'ouest afghan. L’offensive aérienne, mise en place à partir de Tachkent, allait lâcher 10 000 paras sur Kaboul.
Deux jours plus tard, les Forces spéciales soviétiques déposaient les nouveaux dirigeants afghans, et exécutaient leur chef, Hafizullah Amin, immédiatement remplacé par son rival prosoviétique, Babrak Karmal.
Le père de Rustam servait comme officier, dans les unités Ouzbeks de la Sécurité Intérieure, chargées du
renseignement, de la propagande, et de la contre- information. Il est resté mobilisé quatre ans en Afghanistan. Sa fonction, et son grade, lui valurent d’échapper au «cercueil de zinc». Il est revenu sain et sauf.
Les peuples, des deux côtés de l’Amou Daria, sont frères de langue, de culture, et de religion : le Kremlin, constatant la « faible combativité » des unités originaires d’Asie centrale, recourut alors aux Ukrainiens, et aux Baltes. Las ! Le conflit s’enlisa. Le 15 février 1989, toute honte bue, la dernière unité de l’Armée Rouge - la 40è armée commandée par le général Boris Gromov - repassait le bien mal nommé pont de "l'Amitié".
***
Nous sommes revenus à Termez, avant de prendre la route de Dushambé, vers le nord, en remontant la vallée de la Surkhan.
Les anciens sovkhozes alternent avec la micro culture irriguée. Autour des villages, des bijoux de jardins continuent à nourri les villes. Quant à la grande culture mécanisée - coton, céréales, et arboriculture, c’est l’affaire de sociétés capitalistes, seules à même de gonfler les chiffres...
Nous croisons les dernières norias. Les ponts se succèdent entre canaux d’alimentation en béton, rigoles, fontaines, abreuvoirs, et potagers.
La route s’élève, mord sur les collines de lœss jaune sale, barbouillées d’herbe rare, contourne les ravines sèches. Les fonds de vallées cultivées sont couturés de lanières, dans toutes les nuances de vert.
Ici, les corps de ferme sont de hautes bâtisses aux murs de brique crue, et de torchis, supportant le toit de tôle à pans dissymétriques, et prolongées de communs, à l’équerre.
Nous croisons des rassemblements de villageois : les fêtes de Navruz commencent.
Dans de nombreux pays du Proche-Orient, Navruz marque l’arrivée du printemps : c’est le Nouvel An du calendrier solaire iranien, adopté il y a des millénaires.
Un soir, dans un village par ici, nous avons été conviés, à l’improviste, au rituel du soumalak, le repas qui marque le
départ du cycle des cultures, organisé par roulement, par une des familles du cercle de quartier.
Il fait nuit. Les gens se sont costumés. Les musiciens donnent l’aubade.
Sur la terrasse, un énorme chaudron en cuivre fume sur un foyer, sous surveillance étroite. La cuisson a commencé la veille : un liquide couleur caramel composé de farine additionnée de jus fermenté de blé germé. Rituellement, chacun est invité à touiller le mélange, en tirant le manche d’une cuillère géante.
Dans l’appartement, gadgets, cadeaux, et assiettes de friandises s’empilent sur les tapis, et les coussins.
Venus de loin - et donc hôtes de marque - nous avons le privilège de goûter le soumalak nouveau.
Les jeunes ont apporté de la musique en boîte, et se trémoussent. On rit, et on papote.
Les brebis ont été lâchées dans les prairies encore rases, coupées des champs de céréales, par des murets.
Les maisons de pierres se serrent près du ruisseau, tout contre les vergers en fleurs.
Nous contournons des épaulements calcaires, des corniches de grès rouge pointant à travers le lœss, des retombées de falaises sur les éboulis, leurs parois brunes litées de blanc.
La route dévale dans une fissure, sous la falaise, jusqu’à la source « miraculeuse », et, tout autour, une station « familiale » de cure, et de thermalisme, Amoukhana. Plusieurs abris sous roche, le filet d’eau d’un torrent, aujourd’hui à l’étiage, une passerelle, quelque tuyau alimentant les bassins.
Disposés sur la plate-forme accolée au rocher, au soleil, les divans – pardon ! Les tapchan - attendent le client. Tout respire la joie, et Kamol, d’habitude si réservé, se déchaine, et fait le pitre...
Par-là, c’est la fin de l’hiver : les maisons rouvrent, et les chantiers de construction reprennent.
Mais tout là-haut, sur les flancs des Monts Hissar, aux avant-postes du Pamir, l’hiver fait de la résistance.
Cette nuit, la poudreuse a recouvert les plus hauts alpages, isolé quelques fermes, surpris les pêchers en fleur, dans la vallée, et les chatons des peupliers de l’Euphrate.
Nous voici à Boysun.
Nous sommes presque arrivés.
Boysun est une grosse bourgade de piémont, qui jette ses toits gris sur un plan incliné, au pied de la forêt,
et des crêtes rocheuses enneigées.
La rue du Commerce prolonge la route, avec un petit air de ville prospère.
Nous la quittons pour des ruelles de villages, rugueuses, et cabossées, sinuant entre les hauts murs de brique. Encore quelques murs...
C’est ici. Nous sommes à l’heure.
***
Abdousalam, dit Salom, ouvre le portail, et nous accueille, en compagnie de Mavluda, devant le perron, sous la treille
de vigne.
Nous déchaussons, et rejoignons le salon, pour faire connaissance.
Nous papotons, sortons de nos sacs cadeaux, et photos : les « châteaux de la Loire », la maison, nos trois enfants ...
Le bâtiment d’habitation est une longère surélevée comportant salon, salle-à-manger-véranda, chambres, sur plusieurs niveaux, cuisine, et pièces d’eau.
Sur les autres côtés du carré, un grand mur, bordant la rue, et deux corps de bâtiment : une galerie couverte, et un hangar, au-dessus du four à pain.
Au milieu trône le jardin persan, le bassin, et ses poissons, et tout autour les carrés de légumes, les arbustes, et les jeunes arbres fruitiers, en pleine santé : pécher, en boutons, et cerisiers, et pommiers en fleurs. Par derrière, un vaste terrain pentu en herbe, clôturé. Dans un coin, une cabane abrite le « trou chinois ».
L’eau de pluie est récupérée : une cuve extérieure recueille l’écoulement de l’ensemble des gouttières.
Sage précaution : Salom dispose, certes, d’un branchement d’eau potable - un privilège - mais la pression est faible : la borne fontaine publique, dans la rue, fonctionne rarement.
Nous dormons dans la grande chambre de Parvina, 17 ans, et collégienne, entre peluches bisounours, et images Mickey I love you.
La décoration de la maison, les coussins et tapis, les beaux meubles en noyer, tout est cosy, et propice aux confidences, quand vient l’heure du dîner, après le petit verre (« tchout-tchout ») de vodka, puis le plov à l’huile de sésame, un gigot de mouton grillé, et fumé aux aiguilles de pin, le verre de cognac ouzbek, et les confitures maison...
Salom est un enfant du pays : son père a posé les premiers poteaux électriques dans le village, à la fin des années 60. Il possédait le terrain, dont son fils a hérité. Mavluda est née à Dushambé, alors capitale de la République socialiste du Tadjikistan. Son prénom est la variante persane du Maouloud, son mois de naissance (le tadjik est une langue de la famille iranienne, alors que l’ouzbek est classe dans le groupe turco-mongole).
C’est à Dushambé que le couple s’est marié, en 1982. Tous deux artistes, tous deux « montés » en Russie, lauréats des concours, et bénéficiaires de la méritocratie soviétique.
Elle formée dans une école de ballerines. Lui entamant une carrière internationale d’instrumentiste, après des études supérieures musicales.
Mais ils ne sont pas restés à Dushambé, à cause de la montée des tensions, et la lutte des clans, qui ont débouché sur la guerre civile, après l’effondrement de l’Union soviétique...
.
Alors, Salom a fait construire ici.
Pas de regrets, pas de nostalgie...
L’aîné de leurs quatre enfants, le garçon, vit à Moscou. Deux filles sont mariées, et vivent par ici, dans la province de Surkhan Daria : nous les avons vues, elle aussi, avec deux marmots, ainsi que Parvina.
Pour le dîner d’adieu, Salom nous donne un récital, sur ses deux instruments favoris : une cithare qanun à 75 cordes, et le rabab, un luth à cordes pincées.
2019
Chroniques de voyage
San Salvador, Guatemala, Copán, Tikal, Antigua
Joya de Cerén.
Comme un ballet nocturne de lucioles, dans la touffeur de la jungle…
Cernés de haies vives, des myriades de champs-jardins, et de maisonnettes aux fenêtres éclairées. Ce ne sont pas des lucioles, et c’est nous qui bougeons...
Le minicar ahane, et tressaute dans les nids de poule de la chaussée en béton.
En contrebas, nous avions quitté l’aéroport de San Salvador : un souffle d’air chaud nous avait happés au pied de l’avion.
Truffant les arbres de l’aérogare, des bandes de perruches surexcitées poussaient le son à fond : des cris aigres, criards, éprouvants, s’ajoutant à la fatigue, et à la chaleur moite…
Nous étions arrivés.
La communauté paysanne qui vivait ici, il y quinze siècles, a eu le temps de fuir la nuée ardente crachée par le volcan voisin, le Loura Caldeira, sans doute prévenue à temps par des signes avant-coureurs…
Une équipe est à pied d’œuvre sur le chantier de fouille.
Nous sommes penchés au-dessus des fosses, tranchées dans les strates de cendres et de tufs. Un témoin furtif nous observe, volant de poutre en branche. Lorsqu’il se pose à contre-jour, il est reconnaissable à l’aspect unique de sa queue : c’est un Motmot à sourcils bleus.
Devant nous, des fondations en bel appareil de pierres, qui supportaient des constructions d’adobe aux toits de chaume - entre autres, la maison du chaman - les fours, les bains…
On a identifié sur le site des morceaux de poteries, et des graines de manioc.
Non loin d’ici, au nord-est, voici Tazumal. Une bourgade parmi les champs de poupée, les fermes proprettes, et les frondaisons vert fluo.
Dans la rue longeant l’enclos du site archéologique, des échoppes et des étals de fruits et légumes, quelques touristes, et une cohorte bruyante de collégiens en uniformes noir et blanc, garçons en pantalon, et jupes des filles virevoltant au soleil.
Au fond d’une vaste plazza engazonnée se présentent deux pyramides tronquées, trapues, et disposées en équerre : paliers multiples et escaliers centraux en pente douce, par endroit surmontés de rangées de pilastres, mais dépourvus de superstructures.
Le sommet est accessible, sauf à l’arrière, envahi de végétation, et le long des pans de murs effondrés, et barricadés.
A gauche de l’entrée, plusieurs stèles de basalte, posées en désordre, portent des figures gravées, zoomorphes, et anthropomorphes.
A droite, une éminence dissimule les structures empierrées d’un terrain de jeu de balles.
L’ensemble a été dégagé, et restauré, par Stanley Boggs, dans les années 1940 et 1950, puis laissé en l’état.
A la longue, la végétation, reprenant ses droits, a eu raison de plusieurs murs.
Dans la dernière décennie, le site a bénéficié d’un regain d’intérêt, les destructions ont été contenues, et le chantier archéologique, rouvert, est désormais confié à une équipe japonaise.
Son analyse des stèles, de l’architecture, et des rares artefacts échappés au pillage (ossements, céramiques, bijoux en or…) a conduit aux conclusions suivantes : plus d’un millier d’années d’occupation humaine, en alternance avec le site voisin de Chalchuapa, au moins jusqu’au début du second millénaire AD, plusieurs séries de chantiers multiséculaires, pour l’érection des pyramides, et un réseau de relations commerciales « tous azimut » avec les foyers culturels Nahua, et Maya, dispersés entre le plateau central Mexicain, l’isthme de Tehuantepec, Chichen Itza, tout au nord, Copán, plus près, et les rives du Pacifique.
Le site était abandonné au moment de la conquête européenne.
En rejoignant le bus, j’avise, près du muret, un emplacement entre deux commerces, en retrait de la route, parmi les herbes. Au centre, une petite statue sur un socle.
C’est un buste en métal un peu passé. Je reconnais la silhouette d’Ernesto Che Guevara. L’inscription précise que ce monument a été érigé il y a dix ans par le FMLN, pour commémorer une visite du site effectuée par le lider dans les années 1950…
A l’époque, Farabundo Marti (Augusto FM Rodriguez : 1893-1932) était entré dans la légende, au même titre que Pancho Villa (1878-1923), Emiliano Zapata (1879-1919), ou le Nicaraguayen Augusto Sandino (1895-1934).
Pour les intellectuels anti-impérialistes, autant de martyrs de la cause, héros des soulèvements contre l’alliance des oligarques, du haut clergé, et des protecteurs yankees...
Militant patriote, admirateur des révolutionnaires mexicains, et russes, compagnon de lutte de Sandino, Marti avait pris la tête, avec panache, de la résistance armée aux tueurs des cartels du café, et de la junte militaire. Fusillé, à 39 ans.
Aussi, lorsqu’en 1980, l’ensemble de la gauche salvadorienne, appuyée par le régime castriste, fit front commun contre la junte militaire, ce mouvement reçut-il tout naturellement le nom de « Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional » (FMLN).
La décennie qui s’ouvrait répéta le cauchemar des années 30 : la guerre de l’ombre, les mutilations, les liquidations, et les massacres, commis, dans leur immense majorité par la troupe ; ou par les « escadrons de la mort »…
Jusqu’à la signature des accords de Chapultepec (Mexico, 1992).
Désarmement, conversion du FMLN en part politique, et nouvelle tentative de résilience…
.
Il était une fois la révolution…
La Méso-Amérique présente une biodiversité exceptionnelle - montagnes, mangroves, lacs, forêts, savanes, et steppes - sur des sols très variés. Leurs « premiers occupants » y ont façonné un des systèmes de culture « les plus intelligents de la planète ».
« On sait que 11 500 ans en arrière, les paléo-Indiens pratiquaient la chasse dans les grottes de l’actuel Puebla [Etat d’Oaxaca, Mexique]…Ils traquaient le cerf, l’antilope, le lapin d’Amérique, et la tortue géante »…
Le gibier devenu rare, ils se tournèrent vers les plantes, apprenant à faire griller l’agave, à fabriquer des pinces pour récolter les fruits du cactus…Puis ils passèrent aux choses plus sérieuses : courge, gourde, piment, prunier mombin, et autre millet…
Vint enfin le maïs (Zea Mays), au terme d’une éblouissante expérience de génie génétique, commencée il y a probablement 6 000 ans, dans le sud du Mexique.
Non contents d’avoir « créé » le maïs les Méso-Américains multiplièrent les sélections végétales. Depuis des millénaires, ils continuent aujourd’hui à pratiquer une association de cultures qu’ils dénomment milpa : maïs, avocats, haricots, courges, piment, tomate, patate douce, oléagineux, et légumineuses, autant d’ingrédients d’un régime nutritionnel complet.
Abordant les activités intellectuelles, ces sociétés ont notamment élaboré un système d’écriture, et le premier modèle connu de numération de position incorporant le zéro.
Pendant des milliers d’années la Méso-Amérique fut un foyer d’innovation fécond : les Olmèques, divisés en cités rivales, ont initié à l’écriture, au calcul, et aux rudiments de civilisation urbaine, Teotihuacan, Mixtèques et Zapotèques, préparant la formation, plusieurs siècles après, des principautés Mayas.
« Grand Tikal du futur »…
On la surnomme familièrement Guate, et elle vient de loin…
L’Histoire est une science jeune, en Amérique : on a attendu le XXe s. pour se soucier de ces centaines de monticules de pierre qui gênaient les chantiers, en ville : les fouilles de sauvetage ont révélé maillage de rues, bases de temples, stèles sculptées, et autres artéfacts, rétablissant un pan de mémoire de Kaminaljuyú, héritière de Teotihuacan, et contemporaine, pendant plus d’un millénaire, des principales cités mayas.
Le déploiement de l’occupation effective de la Méso-Amérique, entreprise par le conquérant Diego de Alvarado, en 1525, prit deux siècles : la Capitainerie du Guatemala, circonscription du vice-royaume de Nouvelle Espagne (capitale Mexico), s’étendait du Chiapas jusqu’au Costa Rica actuel (le contrôle de la province guatémaltèque du Petén ne fut effectif qu’au début du XVIIIe s).
Après l’abandon d’Antigua, (troisième) siège de la Capitainerie, le titre échut à Guatemala Ciudad. Au tournant des indépendances (1823), elle devint la capitale de l’éphémère Fédération des Provinces unies d’Amérique Centrale. Son territoire reprenait celui de la Capitainerie, amputé du Chiapas (absorbé par la Fédération du Mexique).
Au centre du pays, l’altiplano est un ensemble vallonné de hauts reliefs de piémont, constitués d’épais dépôts sédimentaires d’origine éruptive, incisés de canyons (les barrancos), le tout adossé aux pentes hardies de la chaîne volcanique, parallèle au Pacifique.
Les viaducs de la Panaméricaine survolent la jungle inhospitalière tapissant les à-pics des vallées escarpées, les virages tranchent à vif les strates de tufs (éblouissants de blancheur, jaune, ocre), et des cendres truffées d’éclats d’obsidienne, lacèrent les flancs dépenaillées de collines arides, couronnées de cactus-cierges, figuiers de Barbarie, et autres pommiers de Sodome, avant d’aborder un paysage humanisé : habitat dispersé, cultures intensives, et multiplication des activités à l’approche de l’agglomération-capitale.
Guate est un damier de rues et de quartiers numérotés.
Emergeant du flot des berlines asiatiques, de bons vieux schoolbus jaunes de réforme, reconvertis, tous feux de détresse allumés, trimbalent chromes et peintures criards.
Aux petites maisons andalouses du centre colonial, succèdent les immeubles chics, les parcs, palmiers, et hampes bleu violacé des jacarandas en fleur, un aqueduc désaffecté, et, sur les flancs du plateau, un barranco qui accroche un escalier de taudis, cascadant dans le vide…
Une harmonieuse façade Art Nouveau, tout en courbes, ocre-rose, et blanche, sous les jacarandas : c’est l’hommage rendu par le pays à son brillant passé précolombien.
Le bâtiment a été construit dans les années 30 pour abriter, et mettre en valeur, la principale collection archéologique publique.
Les témoins sont des ossements, des parures corporelles et bijoux, des outils du quotidien, des armes, des fresques et peintures murales, ou des fragments de décors monumentaux.
Aussi habiles architectes et sculpteurs, que bijoutiers accomplis, leurs créateurs ont jonglé avec tous les matériaux, leur insufflant émotion, et vérité : terre, pierre brute, métaux précieux, ou semi-précieux, bois, os, nacre…Les précurseurs réalisaient déjà, il y a 5000 ans, de ravissants médaillons en or martelé, de délicats colliers, et parures de jade, des statuettes composites…
Le style varie du fonctionnalisme le plus étroit, à l’imagination la plus échevelée (ainsi dans la représentation des parades, spectacles, ou combats), puisant dans l’immense « banque de formes » animales, et végétales, qui truffent la jungle alentour. Le réalisme glaçant dans la représentation de corps écorchés, contraste avec l’élégance esthétique des profils stylisés, tour à tour harmonieux, ou difformes, ou encore la truculence, et la fantaisie extravagantes de l’atelier des « chimères » : telles ces cimiers et heaumes des statues royales traitées comme des « pièces montées » entrelaçant hampes végétales, gueules, dents, et griffes, ou ces vases et ces urnes funéraires zoomorphes, d’où se détachent ici un museau de coati, là un bec d’aigle.
Non seulement les Mayas ont bien mérité de la patrie, mais ils ont désormais repris du service : le tourisme booste les affaires.
Nous dormons dans un des quartiers nord ultra-moderne.
La tour de l’hôtel en constitue le temple : 16 étages de chambres autour d’un vide central. Les promoteurs peuvent en être fiers. Ils le sont. Son nom ? Gran Tikal futura. Tout un programme !
Copán vs Quiringa.
Nous prenons la « route de l’Atlantique ».
Passé les hautes collines de tuf, et les gisements d’obsidienne, le relief s’abaisse.
Une végétation xérophile apparait par endroit. Le vent tourne au nord-est. Il apporte la chaleur de la Mer des Caraïbes.
Le Honduras. Copán.
Fusant sous la voûte des grands kapokiers, un trait de lumière, suivi d’un cri rauque. Une tache rouge vif. Un envol bruyant. Un second trait, bleu : les aras nous observent…
Un agouti solitaire déambule sans hâte, furetant, le museau dans l’herbe, indifférent.
Au bout de l’allée, le soleil matinal inonde l’orée du parc forestier. Par le travers se présente une longue clairière. Quelques pas dans l’herbe, et nous voici foulant l’Axe du monde : à gauche, la Grand Place, presque vide. Tout à droite, les hautes structures de l’Acropole.
C’étaient les contemporains de Charlemagne. Ils s’appelaient Nénuphar-jaguar, Fumée-Imix, ou encore Jaguar de Fumée. Ils étaient les Divins seigneurs (K’huhal ajaw), les médiateurs entre le genre humain et les puissances surnaturelles. Ils descendaient majestueusement les marches des temples, pratiquaient le rituel sacré du jeu de boule, ou les sacrifices humains.
En considération de la perfection plastique de ses sculptures en haut-relief, certains ont baptisé Copán « l’Athènes maya »….
Les stèles en tuf volcanique parsemant la Grand Place présentent les Ajaw tenant dans les bras la barre cérémonielle, coiffés de heaumes extravagants, incarnant tour à tour le Dieu du Maïs - absorbé dans la danse de création du monde - ou Chac, émergeant de la mâchoire du monde terrestre…
Pas moins de 7 stèles, splendide dentelle de pierre, sont consacrées à Waxaklajuu Ubaah K’awiil (18 images de K’awiil), celui qui a également consacré le terrain de jeu de boule - admirablement conservé, malgré ses 13 siècles - et entrepris l’érection du grand escalier : 63 marches couvertes de hiéroglyphes, supportant la chronique des rois : en tout, 2200 caractères, soit le plus long texte maya connu, en cours de déchiffrement.
Copán regorge de superbes scènes mythologiques sculptées sur les autels, et les portes : le plongeon primordial du crocodile, au début des temps, les génies soutenant la terre sur leurs épaules, le Dieu-soleil (K’inich), recraché par le bec de l’ara (K’uk), ou celui du quetzal (M’o).
Les fouilles de l’acropole - symbole de la montagne dominant l’océan initial, sur lequel flotte la terre - ont révélé une demi-douzaine de temples emboités. L’un d’eux a été intégralement conservé, et enfoui, avec la tombe du premier roi de la dynastie. Les tunnels d’origine s’enfoncent jusqu’à 15 mètres sous les galeries que nous parcourons.
L’apogée de Copán prit fin en 738, le jour où K’ak Tiliw Chan Yoaa (Cauac-Ciel), roi de la cité sujette de Quiriguá, quelques vallées plus bas, réussit à capturer, et mit à mort Waxaklajuu Ubaah K’awiil.
Affranchi de la tutelle de Copán, Cauac-Ciel se lança dans un vaste programme de construction. Ses successeurs, Xul-Ciel, et Jade-Ciel achevèrent de dupliquer le modèle de Copán.
Les trésors de Quiriguá ont bien failli déménager : en 1840, l’explorateur-diplomate John Lloyd Stephens s’était mis en tête de tout transporter, et remonter aux Etats-Unis. Mais le propriétaire du terrain, el señor Payes, lui réclama une somme extravagante…
Le site archéologique partage le fond de vallée avec la bananeraie héritée de l’United Fruit…
Les tailleurs de pierre de Quiriguá, ont mis à profit les strates de grès de la proche rivière, le Motagua, dans la réalisation de la statuaire, et des autels à la gloire du souverain. Comme à Copán, les stèles - encore plus hautes - de la Grande Plazza, précèdent l’acropole, ainsi que de remarquables blocs zoomorphes aux formes puissantes : grenouilles, serpents, tortues, ou jaguars…
Fronteras.
Au nord du rio Motagua, le rio Polochic draine les eaux des Hautes Terres vers la Mer des Caraïbes. En traversant deux grands lacs (Izabal, et Golfeto), il prend le nom de Rio Dulce, se transforme en chenal entre deux falaises calcaires, et finit dans la baie d’Amatique.
Au bout du lac d’Izabal, un ferry constitua longtemps la seule liaison avec la province oubliée du Petén : certains continuent à appeler l’endroit « Fronteras »…
De facto, jusqu’au XXe siècle, les dirigeants du pays avaient renoncé à mettre en valeur le nord-est, terres basses recouvertes de forêt primaire, réputées impénétrables, et insalubres, et marquées par le souvenir d’une conquête difficile, sur des populations hostiles.
Bien plus, incapables de financer une construction de route vers la Mer des Caraïbes, ils avaient tout bonnement monnayé une large bande de territoire côtier (érigée en colonie, en 1862, sous le nom de Honduras Britannique, aujourd’hui Etat de Belize), contre une promesse d’aide financière. Mais l’Angleterre refusa de payer…
Au XVIIe siècle, des esclaves africains, réchappés d’un naufrage, avaient débarqué sur l’île de Saint Vincent, et s’étaient mélangés aux premiers occupants, des Indiens Caraïbes.
Après avoir résisté, âprement, et en vain, cette population fut déportée par Londres sur une île de la côte hondurienne, où ils faillirent tous périr.
A la fin du XVIIIe siècle, leurs descendants s’établirent en plusieurs points de la côte, du Nicaragua au Belize : leur communauté porte le nom de Garifunas.
Ils constituent aujourd’hui l’essentiel de la population de la guatémaltèque Livingston, près de l’estuaire du Rio Dulce, où Ils perpétuent l’héritage d’une culture originale, Caribéo-Africaine, mâtinée d’influences hispaniques, et françaises.
Il n’existe pas de liaison terrestre entre Livingston, et le reste du pays.
La haute paroi calcaire accroche une végétation hirsute, et plonge dans les eaux émeraude du Rio Dulce. Sur les arbres, là-haut, sèche un étendage de cormorans.
Un héron blanc, juché sur une racine de palétuvier, s’envole à notre approche, puis un autre…
Dans la paroi s’ouvre le canyon d’une vallée secondaire : nous nous y engouffrons un instant.
Quelques carbets sont posés sur la rive, derrière un appontement, et des bateaux. Ils sont habités. Nous croisons une famille en pirogue.
La falaise s’éloigne, derrière la mangrove, frangée de jacinthes d’eau, et de feuilles rondes de nymphéas, piquetées de fleurs blanches.
Les rives du Rio Dulce s’écartent. L’estuaire baigne dans la lumière.
Amarré à quelques encablures de la côte, le peuple bruyant des oiseaux squatte un chalutier : une escouade de grands pélicans bruns défend son territoire, à grand coup d’ailes, contre les menaces d’un commando de sternes qui les invectivent, réfugiés sur la cambuse.
A l’orée de la forêt, Livingston est posée là, à bâbord, accrochant sa frêle chaloupe à un cordon dunaire. Presque ville, protégée de la houle, au fond de la baie.
Un décor de jardin-parc sous les frondaisons. Je suis accueilli par le chant puissant du Bemtivi.
Potagers, poulaillers, et chiens, et deux longues rues entre deux fronts de mer, pour la parade des élégantes. Un semblant de port, côté sous le vent, la plage et les cocotiers, côté vent.
Les coquettes maisons virginiennes à vérandas sont flanquées de bicoques en planches bariolées, et taguées. Un entre-deux étonnant : du provisoire qui dure…
Petén Itza, Seibal.
Le Petén prolonge, au sud, la péninsule du Yucatan : mêmes puissantes assises calcaires, alternance des pluies saisonnières, présence massive de la forêt dense, et faible emprise humaine.
Le relief, et l’hydrographie, s’ordonnent par rapport à un V : la branche orientale, irriguée par les fleuves côtiers du Belize, à travers les Monts Maya ; et, à l’ouest, la sierra de Lacandon (au Chiapas), où s’écoulent les affluents de l’Usumacinta.
Dans la dépression centrale, l’eau pose souvent problème. Mal drainée, elle forme des lacs, souvent minéralisés, et des marais, ou alors, elle fait totalement défaut en surface.
La route court vers le nord, de forêt primaire en défrichement. Elle avale ravins, pontets sur les arroyos, s’accroche, en virages serrés, aux flancs des Monts Maya, dépasse tel ranch solitaire, tel village pionnier, et sa petite église blanche, et s’immerge dans une jungle mâtinée de bocage, sous l’œil indifférent des zébus au pré, et de leurs associés, les petits hérons pique-bœufs blancs.
Le glyphe-emblème de Yaxhá (« eau bleu-vert ») annonce la couleur : il y a 2500 ans, la cité surplombait déjà la rive orientale d’une lagune d’eau douce. Réfugié dans une île, son quartier le plus récent - Topoxte - est contemporain de l’arrivée des Espagnols.
La piste d’accès traverse la forêt dense.
Le site est très vaste. Seule une petite partie a été fouillée, et partiellement restaurée, depuis le travail pionnier de son « découvreur », l’allemand Yacob Maler (1904) : plusieurs groupes de hauts temples-pyramides - dont un exemple unique de pyramides jumelles - observatoires astronomiques, autels, et terrain de jeu de balle, reliés par les majestueuses routes d’accès d’origine (les sacbeob, ou « chemins blancs »).
Le sous-bois est accidenté de nombreuses constructions encore enterrées.
Nous essayons d’imaginer le peuple massé sur les places, en contemplation devant les cortèges chamarrés des dignitaires…
Sur le site voisin de Naranjo, encore plus vaste, les archéologues déchiffrent des stèles qui racontent une histoire dynastique commune aux deux cités : il y est question des épousailles de Dame Coquille-Étoile avec un souverain de Naranjo, et aussi d’une guerre qui couta la vie au roi de Yaxhá…
Depuis le sommet du plus haut temple de Yaxhá, la vue porte loin : la canopée ondule à perte de vue, au-delà du miroir lumineux de la « lagune », au premier plan.
Le lac Petén Itza occupe le centre de la province.
Le peuple des Itzas a une longue histoire. Les ancêtres ont formé de puissantes cités Mayas, et donnèrent du fil à retordre à Hernan Cortés, avant de défier les autorités guatémaltèques. Retranchés, notamment, dans une île du lac - qui s’appelait Jayazal, avant de devenir Flores - ils se préservèrent en cultivant une réputation de férocité.
Ils ne sont plus qu’un millier à parler leur langue.
Blottie dans son îlot, Flores s’est convertie en paisible quartier colonial, au charme un peu maniéré, sous la double protection, en haut de la butte, de Nuestra Señora de los Remédios, la blanche, et de l’ayuntamiento. Flanquant les ruelles pavées, dévalent des rangées multicolores de maisonnettes, petits commerces, et autres auberges.
C’est aujourd’hui Mardi Gras : dans les villages traversés, nous croisons des cortèges grimés, et colorés : les enfants, et les mamans, et les jeunes se trémoussent derrière les orphéons.
La route s’arrête sur la berge du rio Pasión. Les eaux de la rivière s’écoulent lentement vers l’ouest, en larges méandres, en direction de l’Usumacinta, et, au-delà, du Golfe du Mexique.
Il n’y a pas de pont. Nous prenons le bateau pour rejoindre Sayaxché, sur l’autre rive. Les bacs au moteur poussif sont chargés au-delà du raisonnable.
Après Sayaxché, la piste s’enfonce dans la jungle, dans la direction du site de Seibal.
Des panaches jaunes de fleurs de sapotilliers couronnent l’orée de la forêt.
A l’arrivée, le comité d’accueil est composé d’une bande de singes hurleurs, postés en haut des grands ceibal. Ils s’époumonent, vitupèrent, et vocifèrent à qui mieux mieux, ameutant la forêt dont la voûte répercute loin, en écho, leurs cris rauques, profonds, et puissants.
Seibal est relativement énigmatique. Elle semble avoir connu une existence courte, et tardive (fin du 1er millénaire), mais intense . Les fouilles - récentes - n’ont pas permis d’attester ses origines : certains personnages, sur les stèles, portent moustache, et tunique, tous détails étrangers au monde maya.
Plusieurs stèles sont fort belles et bien conservées (telle celle représentant un collecteur d’impôt). Les rares temples visibles sont de petite taille. Une structure étonnante, et qui pourrait bien avoir été un observatoire, est placée au centre d’une clairière, à côté d’un autel en forme de jaguar : un anneau circulaire flanqué de trois marches.
Las Dos Erres.
C’est un joli nom, «La Libertad» !
Il désigne une commune du Petén, adossée au Chiapas (Mexique).
En 1976, des migrants y avaient investi un hameau pionnier, Las Dos Erres.
Ce nom-là est désormais tristement célèbre, dans un pays qui préfèrerait oublier ses 626 villages martyrs…
Le 6 décembre 1982, les membres des forces spéciales encerclèrent la population, séparèrent les hommes, pour les torturer, enfermèrent les femmes et les filles dans l’église avant de les violer, et, pendant deux jours, firent périr plus de 200 personnes, y compris les bébés, jetant les corps dans les puits. Les autorités attribuèrent le crime à la guérilla, un mensonge révélé par le consul du Canada…
Selon la CIDH, « le massacre de Las Dos Erres a été planifié et exécuté dans le cadre d’une politique de la terre brûlée, dirigée contre la population, considérée comme l’ennemi intérieur ».
Cette guerre, non pas « civile », mais contre les civils, officiellement initiée en 1960, par la répression d’un soulèvement d’officiers libéraux, avait, en réalité, débuté par le renversement du Président Arbenz, en juin 1954 : un coup de force orchestré par les Etats-Unis, conçu par la CIA, et exécuté par des troupes entrainées au Honduras.
Arbenz, comme son prédécesseur, le réformiste Arévalo, entendait redistribuer les terres, notamment 85 000 ha en friche appartenant à la nord-américaine United Fruit.
Si cette question fut l’élément déclencheur du conflit, tout aussi déterminante fut la condition des indigènes : ils ont constitué la majorité des victimes du crime, bien au-delà de leur part dans la population.
En 1944, dans les colonnes du journal El Imparcial, le journaliste Guerra Cortave s’exprimait ainsi : « Nous sommes opposés à ces compatriotes ignorants, sales, paresseux, malades, licencieux, sans conscience […] Nous nous trouvons parfois d’accord avec ceux qui préconisent leur disparition graduelle par n’importe quel moyen qui pourrait diminuer progressivement leurs rangs… ».
Les acteurs de la réconciliation se sont mobilisés prioritairement pour la reconquête de la « fierté », et l’obtention effective des moyens, intellectuels, et matériels, du développement solidaire.
Quant à la réparation morale, elle a subi les errements de l’appareil judiciaire « ancien »…
Celui qui portait la responsabilité suprême des massacres, l’ancien président Rios Montt, est mort dans son lit. Plusieurs militaires en retraite ont été jugés. Cinq condamnations à 6000 ans de prison ont été prononcées en 2011 et 2012 contre des auteurs du massacre de Las Dos Erres, et, un autre, Santo Lopez, en 2018, a été condamné à 5160 années (30 pour chacune de ses 171 victimes), et 30 ans pour crime contre l’Humanité.
Le film « Nuestras Madres » récompensé par le prix Caméra d’or lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2019, évoque les disparus, la recherche de la vérité, et la résilience. L’auteur de « S21, la machine de mort Khmère Rouge », le cinéaste d’origine cambodgienne Rithy Panh, présidait le jury, et a remis le prix au Guatémaltèque César Diaz.
Grande patte de jaguar vs Grenouille qui fume
Il s’appelait Chak Toh Ich’ak (Grande patte de jaguar), et régnait pour la dix-huitième année sur une cité prospère du sud du Yucatan.
La réputation de Mutal était parvenue jusqu’à la Cour de l’empereur, à Teotihuacan, éveillant sa convoitise...
Chak Toh Ich’ak, victime d’une erreur d’appréciation fatale, avait offert une réception, en son palais, à une délégation de Teotihuacan : diplomatie oblige !
Sans rien changer à son train de vie, voluptueux, entre obligations rituelles, danses, et repas servis par des nains, au milieu d’un concert de conques, et de trompes en bois, ce 14 janvier 378, il avait tout lieu de penser qu’une fois de plus, il allait éblouir ses hôtes.
En face, le chef de la délégation était un guerrier auréolé de gloire (il venait de soumettre quatre cités Mayas), le général Siyah Ka’k’ (Grenouille qui fume), et aussi le plus proche conseiller de l’empereur.
Peut-être, ce jour-là, l’aspect du roi de Mutal correspondait-il au tableau des effigies « officielles » sur les bas-reliefs, et les stèles : grand, et athlétique, le torse nu émergeant d’un long pagne de coton, couvert de bijoux, de la tête aux pieds, un haut diadème en forme d’oiseau de proie à l’abondant plumage, juché sur le front ?…
Il se peut que l’entrevue ait été brève : Siyah Ka’k’, à la tête de ses soldats - colliers en coquillages, torse nu sur des jambières, et des sandales, coiffés de casques carrés, des miroirs circulaires dans le dos, parmi une forêt de lances et d’atlatls - était sans doute pressé d’accomplir le destin, pour sa plus grande gloire personnelle.
Nous ignorons si les soldats Mayas, parés de peaux de jaguar, eurent le temps, ou même reçurent l’ordre d’intervenir : l’iconographie suggère un massacre des dirigeants de Mutal, après que l’assassin préposé aie planté le couteau dans la poitrine de Chak Toh Ich’ak, conformément à un rituel bien établi, le renvoyant ad patres « traverser les eaux », selon l’expression en usage.
La dynastie intronisée par Teotihuacan contribua à un nouvel essor, et à une féroce compétition avec sa voisine du nord, Kanaal ;
Un des épisodes de cette guerre de deux cents ans, récemment déchiffré par les épigraphistes, se déroula le 29 avril 562.
Les mercenaires à la solde de Kanaal se lancèrent à l’assaut, armés de lances, de hachettes, et de masses d’arme, encadrés par les effigies religieuses, peintes sur de vastes litières.
Le jour de l’attaque n’avait pas été laissé au hasard : il correspondait à l’apparition de Venus dans le ciel matinal, un augure favorable entre tous…Mutal fut prise, sa dynastie déchue, les conquérants laissant les choses en l’état. Mutal mit un siècle pour reconstituer ses forces ;
Les guerres reprirent, engageant les dizaines de cités Mayas assujetties à l’un ou l’autre camp.
Chaque nouvelle rencontre voyait se répéter les mêmes scènes : « il y avait des mares de sang, et les crânes des soldats de Mutal s’empilaient aussi haut qu’une montagne », nous raconte une inscription gravée.
Mutal finit par l’emporter, brisant une dernière attaque, en 682, à l’issue de laquelle fut confisquée l’effigie de la divinité protectrice de Kanaal - un grand jaguar sacré - et après une parodie de procession rituelle à travers la cité, au cours de laquelle l’image du dieu de la cité vaincue avait été promenée, accrochée à l’arrière de sa litière, punie…
Kanaal, ruinée, et abandonnée, sombra dans l’oubli…
En février 1848, le gouvernement dépêchait sur place le colonel Modesto Méndez, corregidor du Peten, aux fins de réaliser une mission de reconnaissance. Il était guidé par le Gouverneur, et accompagné d’un artiste, Eusebio Lara. Le texte de leur journal d’exploration, publié dans la Gazette du Guatemala en avril, fut repris dans un livre édité par l’Académie de Berlin (avril 1853) : le succès fut immense, déclenchant une vague internationale de curiosité.
Le monde découvrait une nouvelle civilisation.
Premier visiteur « étranger », le Suisse Gustav Bernoulli, rapporta de superbes linteaux en bois extraits des temples I et IV, aujourd’hui visibles au musée de Bâle.
Puis vinrent les archéologues : Alfred P.Mausley, Téobert Maler, R.E.Merwin, et surtout Alfred M.Tozer, qui y travailla jusqu’à sa mort, en 1954. Sylvanus G.Morley déchiffra les inscriptions.
A partir de 1956, l’université de Pennsylvanie, et les scientifiques guatémaltèques, prirent le relais.…
Tikal
Israël, notre guide, a passé la journée d’hier avec un couple de français, et leur fille. A 7 ans, celle-ci s’est prise de passion pour l’épigraphie…
Voici messire le coati à nez blanc. En Castillan, pizote. De la taille d’un chat. Museau rigolo, pelage abondant, et queue bien fournie. J’ai fait la connaissance, en Argentine, de son cousin méridional, le coati roux (son portrait tout craché). Celui-ci nous snobe. Même chose pour le dindon ocellé. Quant aux singes atèle rien d’étonnant à les voir s’agiter, là-haut : c’est leur habitude…
Le cœur de Tikal a cessé de battre il y a douze siècles… A l’apogée de la cité, ce coeur se situait quelque part sous l’acropole nord, ou la Gran Plazza. Là, deux temples se font face : celui du Grand jaguar (Temple I) tient son nom des belles gravures des linteaux en bois de sapotillier, devant la plate-forme cérémonielle : Jasaw Chan K’awill 1 (numéro dynastique 26) y est représenté sous la protection d’un jaguar, lèvres retroussées, et griffes sorties. L’autre édifice (Temple II), plus petit, mais aussi plus ancien, a été érigé pour l’épouse de n°26.
A quelque distance se dresse le plus haut bâtiment de tout le monde Maya (Temple IV, dit du Serpent bicéphale). Il fut érigé par leur fils. Le musée de Bâle conserve un magnifique linteau sculpté : le serpent, surmonté d’une chouette, les ailes ouvertes, vomit des volutes, ornées de phrases.
Depuis son sommet (à 70 mètres), la vue se déploie sur la canopée, au-delà de la façade du Temple I, et des couronnements de trois autres pyramides.
Au hasard du circuit, nous repérons au sol une cavité creusée dans la pierre : il s’agit d’un regard de canalisation (un chultun) : sur un sol calcaire, l’approvisionnement en eau d’une grande concentration humaine posait problème.
De vastes réservoirs (les Agudas) furent creusés : ils se remplissaient pendant la saison des pluies (l’étang près du pavillon d’accueil était l’un d’entre eux). Un vaste réseau de conduites recueillait l’eau de ruissellement des monuments, des places, et des rues, et les chultun permettaient d’en vérifier le fonctionnement.
Quel plaisir que de flâner dans la forêt à broméliacées, d’une pyramide à l’autre, sur les larges chaussées en calcaire pilé, et de scruter, à contrejour, le pic crocheté au tronc de l’acajou, ou du cèdre, et le perroquet gris, juché au sommet du ceibal-kapokier !…
Le plus beau lac du monde.
Le promontoire d’Iximche (littéralement "Noix-pain") est cerné de ravins.
Dans ce site de défense naturel, les Cakchiquel installèrent leur capitale à la fin du XVe s. délaissant les abords de la forteresse de K’umacaaj, tenue par les Mayas Quiché, pour cause de fâcherie.
Ayant noué alliance avec les Espagnols de Pedro de Alvarado, en 1524 ils les autorisèrent à en prendre possession. La brouille ne tarda pas, et tout comme les Quiché, ils perdirent la partie. La ville fut brûlée en 1526, et abandonnée.
Aujourd’hui, c’est un parc arboré bucolique, bien entretenu, où sont dispersés les places de cérémonie, et leur système de drainage. Les fouilles ont dégagé les structures de temples et de palais - et des jeux de balle, mais pas de stèles.
En ce moment, un groupe est réuni pour un rituel chamanique, autour d’un foyer, largement alimenté en alcool, et en paraffine…
Il y a le cimetière marin …et puis, il y a celui de Sololá (du cakchiquel Tzoloya).
Il est posé sur un balcon, au-dessus du lac Atitlan. En fond de tableau, une double silhouette bleutée : les cônes volcaniques parfaits, alignés, du Toliman, et de l’Atitlan.
Une paisible bourgade, avec ses quartiers pavillonnaires de tombes individuelles, et ses alignements d’immeubles : de hautes façades aveugles de caveaux superposés, peints de couleurs vives, couronnés de frontons, et de toits à double pan…
Il est désormais célèbre jusqu’aux confins du système solaire.
« Le lac Atitlan est le plus beau du monde », s’extasiait le grand Alexander von Humboldt. « C’est comme le lac de Côme embelli de volcans immenses. Il est vraiment au-dessus de tout » (Aldous Huxley). Il parait qu’il a inspiré Le Petit Prince à Antoine de Saint Exupéry : le boa avalant l’éléphant reproduirait la montagne de Cerro de Orro, vue d’avion…
Pour les scientifiques, il provient d’une éruption cataclysmique (il y a 85 000 ans). L’expulsion d’une énorme quantité de matière, a creusé une caldeira de 160 km2, où s’accumula l’eau de pluie. Le relief fut complété, 20 000 ans après, par un nouvel épisode éruptif, accouchant de plusieurs cônes, dont certains dépassent 3 000 m : le San Pedro, à l’ouest, et le couple Toliman - Atitlan (le plus élevé), au sud.
En raison de l’activité sismique, le niveau du lac varie, des failles venant périodiquement modifier les conditions d’infiltration.
Ici, on l’appelle « grand-mère Atitlan », avec un mélange d’affection, et de dévotion…
Dans les bourgades perchées sur l’eau, à distance des caprices du lac, les femmes Tz’utujil, et Cakchiquel, continuent à porter le sombrero - tocoyal - la jupe bouffante à rayures violettes, ou longue - corte - bleu foncé, la tunique - huipil - brodée d’oiseaux, et de fleurs fantaisie, quand les vieux messieurs arborent le pantalon de laine à rayures lavande, et marron.
Santiago Atitlan revendique son identité indigène.
Dans l’église paroissiale, les statues des saints, alignées, viennent de recevoir leurs nouveaux vêtements, confectionnés par les dames, pour les fêtes pascales.
Le retable central du chœur - ils sont trois, un par volcan - représente deux « confrères » (membres d’une cofradia) sur la montagne sacrée, près d’une grotte : le paradis maya…
Contraste : une plaque, à l’entrée de l’église, honore la mémoire du père Stanislas Francis Rother, missionnaire assassiné ici, en 1981, par les escadrons de la mort.
A Santiago, chaque famille s’honore de recueillir, à tour de rôle, pendant un an, l’effigie vénérée d’un personnage énigmatique, mi-dieu mi-saint, facétieux, fumeur, bon buveur, et coureur de jupons. On l’appelle Maximón, ou encore San Simon. Serait-ce un dieu amérindien revêtu des oripeaux de Pedro de Alvarado, un avatar de saint Simon, ou encore de Judas? Nous lui rendons visite chez ses hôtes du moment. Débonnaire, affublé de santiags, dûment cravaté, et chapeauté, il reçoit son lot quotidien d’offrandes, alcool, tabac, fleurs et argent.
Tous prêts l’un de l’autre, en bateau, voici les deux bourgs pentus de San Antonio Palopo, et Santa Catarina Palopo : fières façades baroques de leurs églises (leurs nefs tendues de voiles bleu-or, ou violet) baignées de lumière, jardinets en terrasse, étroites rues pavées, ombreuses, immeubles modernes bousculant les maisons d’adobe au toits de chaume, ou de fer blanc, boutiques de babioles, et ateliers de tissage sur des métiers à bras…
Le soleil couchant a repeint de rose le panache des nuages au flanc des volcans. Un petit vent frais ride les eaux vert émeraude. Les poules d’eaux regagnent leur gîte.
Xela, Huehue, Chichi, et pépé Manuel.
Par sa population, c’est la deuxième ville guatémaltèque.
Les indigènes préfèrent l’appeler par son nom maya : Xelaju (ou, mieux, Xela). Celui de Quetzaltenango est trop marqué par la défaite du dernier roi Maya, Tacun Uman, non loin d’ici, en 1526…
Nous mangeons dans un restaurant au faste « Belle Epoque ».
En ce temps-là, l’importante minorité allemande locale s’enrichissait dans le café, sur les bonnes terres dont les indigènes avaient été spoliées…
En 1909, le planteur Hugo Fleishmann avait construit la « Villa Lesbia » (le prénom de son épouse) : quarante pièces, et trois salles de bains …
Vinrent les temps difficiles, des successeurs improbables, tel un Séminaire (les fresques italianisantes osées - chérubins, Bacchus, amours et autre Cupidon - n’y survécurent pas…). La maison, réputée hantée, fut sauvée de justesse par le coup de coeur d’un cuisinier...
Plus de fantômes ! A leur place, une collection d’antiquités. Les lustres, l’escalier, et les meubles d’époque : tout est kitsch, dans le style des années 1900.
En fond de tableau, les cônes volcaniques, dont certains sont actifs. Des vallées verdoyantes, et des sources, chaudes, ou froides, au pied de collines escarpées, couvertes de bois de pins.
La terre porte de splendides cultures potagères : c’est un des garde-manger du pays, et le marché de gros de Zunil expédie vers les pays voisins du sud.
Au bord de l’allée, nous croisons le paysan qui arrose ses plants avec une sorte de pelle…
D’une bourgade à l’autre, la variété des styles est des plus étonnantes.
Sur fond de volcan - le redoutable Santa Maria - la façade blanche de l’église coloniale de Zunil étincèle, par-dessus des toits rouges des maisons basses.
Ses seize colonnes torsadées sont assorties à celles du chœur. L’autel est en argent, richement travaillé, tout comme les broderies des robes, sur les statues des saints.
La façade de l’église de San Andrea Xecul, à l’opposé, est fantasque et spontanée : jaune safran vif, sous un débordement de couleurs franches : un spectacle vivant animé de figures de saints, d’anges virevoltant, croisant un couple de jaguars, parmi les bouquets de fleurs, et les pampres de vigne, sous un clocher calotté - tel un chapiteau - de rouge, bleu, et jaune.
Dans la nef, la figure sanguinolente du Christ martyr brille à la lueur des cierges.
A hauteur de Huehuetenango (Huehue), l’altiplano continue vers le nord, mais le pays des volcans fait place aux terrains cristallins de la Cordillère de los Cuchumatanes.
Le Mexique est tout près.
Tournant le dos aux volcans, la route monte en lacets jusqu’au mirador Juan Diéguez Olavierri. Plusieurs panneaux rendent hommage à ce poète local, avec des extraits de son œuvre nostalgique du temps de l’exil.
Todos Santos Cuchamatan, au flanc boisé du sommet de la cordillère, anime de son marché, et de ses services, une région enclavée, longtemps pauvre, pays de migrants intérieurs (sur les plantations de rente) et d’émigrants vers le Mexique, et les Etats-Unis.
Dans les années 80, l’extrême insécurité politique aggrava encore la situation, alimentant le flot de réfugiés vers la frontière.
La situation s’améliore. Les « étrangers » ont construit, et font marcher le commerce.
Les costumes traditionnels sont omniprésents. Nombreux sont les hommes à porter le traditionnel pantalon rayé rouge, et blanc, le chapeau de paille orné de rubans bleus, et la veste aux rayures multicolores.
Elle fut une importante cité marchande cakchiquel, dénommée Chaviar. Puis les Quiché s’en emparèrent, la rebaptisant successivement Chuguila (« au-dessus des orties »), puis Tziguan Tinamii (« entourée de canyons »).
Finalement, les Espagnols lui attribuèrent un nom nahuatl : Chichicastenango.
Chichi, aux ruelles pavées, et aux toits de tuiles rouges, possède ses propres institutions, élues par les indigènes : des chefs civils et religieux, sous l’autorité d’un conseil, d’un maire élu, et une justice spécifique, doublonnant institutions de l’Etat, et de l’Eglise.
Une fresque sur le mur de l’Hotel de Ville rappelle, à ce sujet, le prix du sang payé par la communauté indigène locale, pendant les années de plomb.
Ce matin, les habitants se pressent autour des officiants, les chuchkajaues (« mères, pères »), sur le parvis de l’église Santo Tomes, pour des cérémonies mêlant animisme, et christianisme.
Le sol est jonché d’offrandes - bougies, céréales, fleurs, bouteilles d’alcool - et d’épaisses volutes d’encens, et de fumée, enveloppent l’escalier : sous les marches sont enterrés des ancêtres, à l’instar des rois Mayas, sous les degrés des pyramides…
Certains villageois ont marché des heures, leur marchandise sur l’épaule. Les portefaix, arque boutés, leur charge sur le dos, tirée par la sangle entourant la tête, déboulent sur les trottoirs, le front en avant. Une vague de toits de tôle et de toile, recouvre la place, et les rues alentour : ici, fruits, légumes, viandes et poissons, là, les vêtements et articles ménagers, là-bas l’artisanat pour les touristes : masques, tissus, et autres poteries.
Chez pépé Manuel (la casa del abuelo Manuel) on accueille en famille le voyageur de passage, en lui réservant, après le repas, un spectacle présenté par les hommes.
Pour se moquer des Espagnols : dans la scène de la corrida, il faut - et il suffit - de se trémousser sur un air ancien, transfiguré sous l’habit de lumière - veste, gilet, culotte, pendeloques, galons, et miroirs - le buste couvert d’un plastron emblasonné, sous un masque de visage - rose comme peau de bébé, avec un petit nez retroussé comique, sur de fines moustaches - un immense bicorne emplumé multicolore sur le crâne, d’agiter une capote par devant, en cadence, et de multiplier les passes, en poussant de sonores « olé », alors qu’un figurant - un jeune garçon, de préférence - simulera le Toro, reconnaissable à la paire de corne, lancé dans sa course folle…
« Métissage », un gros mot ?…
«Pour commencer, nous [devons] nous réconcilier avec nos origines hispaniques… [qui] renferment la diversité dont nous avons besoin pour vivre dans notre temps.
Loin de nous isoler, nous devons ouvrir nos frontières mentales vers l’avenir, et vers le passé. Vers l’avenir, en nous laissant porter par la vague d’intégration et de contacts qui déferle sur notre monde, dans tous les domaines. Vers le passé, en apprenant à lire notre histoire comme s’inscrivant dans celle du monde hispanique, par là-même, dans l’histoire de l’Occident.
La plus grande erreur que commet notre enseignement, selon Luis Gonzalez [historien mexicain, 1925-2003], est de placer sur le même plan l’histoire du Mexique, et celle de ce que nous appelons aujourd’hui le Mexique. L’histoire du Mexique commence longtemps après celle de son territoire actuel…
Une telle confusion…peut nous faire croire que les Mexicains sont plus Olmèque que Musulman, ou plus Teotihuacan qu’Andalou…
Et j’ajoute qu’à cause de cette confusion, nous nous sommes privés absurdement d’enseigner notre histoire comme ce qu’elle est, un carrefour de cultures, en consacrant autant de temps à la civilisation espagnole qu’aux civilisations indigènes …
Nous devons…remettre à l’honneur l’expérience ibéro-américaine de la diversité dans l’unité. Celle-ci [a, pour partie] commencé par la présence grecque et romaine dans la péninsule ibérique, et se poursuit aujourd’hui avec cet hispanophone sans papiers, qui cherche sa place dans l’économie des Etats-Unis, s’implante, et se mélange, mais en même temps, résiste, comme la frontière culturelle ibéro-américaine a résisté à travers les siècles face aux Etats-Unis…
Il n’est pas de meilleures ressources que celles qui, dans notre histoire, nous parlent de contact, de mélange et d’assimilation, pas de meilleures ressources que l’identité métisse, et la vigueur culturelle de la matrice hispanique, l’une des plus puissantes de l’Occident.
Une telle tâche mérite qu’on y jette toutes nos forces ».
Ces propos d’Aguilar Camin (historien, écrivain, et directeur de la revue mexicaine Nexos), tenus lors d’un congrès à Almeria, en 1993, concernent tous les Indo-Américains, et quelques 600 millions d’hispanophones, un vaste cortège, en somme…
Un ange passe…
Un damier de constructions basses, et de jardins, étalé dans une plaine intérieure verdoyante - la vallée de Panchoy - sertie de velours sombre : les flancs boisés, tout en rondeur, de trois hautes silhouettes, couronnées de crêtes rocheuses, géants d’apparence débonnaire : l’Agua, le Fuego, et l’Acatenango.
Les bourgades alentours se nomment San Antonio Aguas Calientes, Santa Maria de Jésus, San Cristobal El Boajo, ou Santa Anna. Dans les villages, on parle aussi Cakchiquel. Plus loin, plus haut, dans les contrées plus reculées, le castillan n’est pas encore compris par tous…
Les temps changent : les dynasties du café accueillent les visiteurs curieux.
Sur telle finca, fondée en 1883, le parcours comporte un petit ethno musée sonorisé (les visages, modes de vie, intérieurs, musiques, instruments, et scènes de fêtes des travailleurs, sont enfin honorés) un espace didactique sur le café, de la plante au produit, l’aventure historique du goût, et du marché, et, sur le terrain, une promenade parmi les tous jeunes plants osant leurs fleurs nouvelles, délicates, légèrement parfumées, sous les grands arbres.
Elle ne fut pas toujours « Antigua »…
En septembre 1541, le volcan Agua - son nom Maya était Hunahpù - connut une éruption meurtrière : glissements de terrains, et inondations ravagèrent Tecpan, (Ciudad Vieja), où Pedro de Alvarado avait installé ses quartiers. La plus célèbre des victimes fut sa veuve en secondes noces, qui venait à peine d’être élue Gouverneure pour lui succéder…
On choisit pour la reconstruire, la vallée toute proche de Panchoy, sous l’appellation officielle : «muy noble y muy lea ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala» en réinstallant les piliers du pouvoir (Gouvernorat, Commandement général, et Tribunal), rejoints, plus tard, par l’Université San Carlos.
La cité-modèle, couverte d’églises, et de couvents, compta bientôt 50 000 habitants.
Mais en 1773, elle connut un sort aussi funeste qui avait présidé à sa naissance : pendant des mois, la terre trembla, semant les destructions, et la mort. Nouveau transfert.
Néanmoins, le site ne fut jamais abandonné : derrière les façades de plusieurs églises - qui, généralement, avaient mieux résisté que les nefs - on restaura.
Tel église rebâtie, puis à nouveau ruinée en 1977, a été reconstruite encore plus belle…
La muy noble y muy lea ciudad de Santiago de los Caballeros fut un rêve trop ambitieux. Restent la splendeur du baroque - cette signature universelle de l’Europe chrétienne - toujours renaissant, et la mémoire enfouie de l’Espagne de Cervantès.
Le cycle des « processiones de Semana Santa » culmine entre Passion, et Résurrection, mais commence avec le temps de Carême.
En fin d’après-midi de ce premier dimanche de Carême, la lumière est encore vive.
Les visages se tournent vers la ligne de fuite de la Quarta Calle Poniente.
Nous cherchons la tête du cortège, essayant de deviner l’ordre d’apparition des figurants…
Les confréries ouvrent la marche, sous leurs couleurs, encapuchonnées, entourant les porteurs de leurs saints protecteurs respectifs.
Suivent les ordres religieux, et les témoins de la Passion : lances, et oriflammes des fantassins romains, authentiques du casque à cimier, jusqu’à l’extrémité des sandales, toge de couleur sur les jambes nues. Le peuple de Jérusalem suit : dignes palestiniens, et fiers bédouins en gandoura blanche sous le keffieh tenu par l’agal.
Voici l’heure entre chien et loup. Un halo de lumière, et son reflet sur le pavé se déploient, et se rapprochent. Jailli d’une rampe de vive lumière, comme flottant au-dessus des têtes, un Christ en majesté, et habits de fête, supporte sans effort apparent une croix finement appareillée, et dorée, entouré de ses proches. Dans l’ombre, des dizaines d’hommes, tout en bleu, supportant le piédestal, à bout de bras, et oscillent en cadence.
La nuit est là. La lumière enveloppe le tableau final, blanc, or, et pastel : une Madone couronnée, derrière l’enfant Jésus debout, de petits personnages à ses pieds, bénit du bras droit. Les cuivres scandent de notes graves la marche triomphale.
Sans avoir prononcé nos vœux, nous voici dans les murs du couvent Saint Dominique…
Il y a de cela quatre siècles, ce fut le plus vaste, et le plus fastueux des monastères d’Antigua. Ravagé par le séisme, puis abandonné, il vient de se métamorphoser : les aménageurs ont logé, dans ses vastes volumes, sur les puissants murs porteurs, chambres d’hotel, et restaurant, créé des espaces culturels - plusieurs salles consacrées à l’art et d’histoire - et des boutiques, consolidé la partie préservée de l’église, et, entre des pans de murailles décatis des anciens communs, dessiné, et fleuri, des bassins, et autres patios.
Pour plus d’authenticité, encore, les hôtesses d’accueil ont pris l’habit des Dominicaines…
La richesse du patrimoine religieux d’Antigua me laisse songeur : c’est un concentré de chefs-d’œuvre, même les ruines : sans doute le sentiment éprouvé par les romanciers-voyageurs d’antan, « redécouvrant » les Antiques Romains, Palmyre, Tipasa, ou …nos cathédrales.
Mais d’où vient l’acharnement à reconstruire, et embellir sans cesse, ce que le temps, et la nature, rudoient ? Certainement pas l’entêtement d’esprits attardés !
J’ai déjà vu ça bien des fois : au Tamil Nadu, les tailleurs de pierre remplaçant les statues, sur des Gopuram vieux de 1 500 ans, ou les tapis d’ateliers traditionnels Iraniens recouvrant l’immense mosquée dernier cri de Mascate… .
De fait, nous ne vivons pas la fin de l’histoire …de l’art.
Sous-tendue par la foi, l’énergie des artistes « inspirés », et l’intelligence des investisseurs avisés, elle poursuit son chemin de par le monde. Le but initial s’enfuit, comme l’horizon…
Ravi, je regarde, j’écoute, et j’interroge. Touriste consciencieux, j’achète, et je feuillette un guide-souvenir, vérifiant in situ, que tout concorde : photos - très - bien léchées, et réalité.
Voici l’arc de Sainte Catherine, couleur safran, et son horloge rapportée, devant la silhouette du volcan Agua : tout ce qui reste du couvent. Sur cette passerelle enjambant la rue, les religieuses pouvaient traverser incognito…
Flanqué de la statue de Bartholomé de Las Casas, l’éclatant baroque mexicain tardif, or, et blanc, de la Merced, deux fois ruinée, et reconstruite, cloître et bassin, sous les bougainvillées. Et aussi St Jacques (la cathédrale), façade digne, nef aux coupoles crevées, et crypte indemne, le monastère des Capucinas, son étonnante Torre de Retiro , et bien d’autres vestiges magnifiques : le monastère St François, la façade de la Candelaria, dans un terrain vague, la nef de Sainte Rose de Lima, derrière les grilles d’une parcelle privée…
Tout au centre du quadrilatère urbain trônent les palais de la ville, et du gouverneur. Le vaste jardin-parc public est agrémenté de gerbes de fleurs - arbres-corail, nazarenas, jasmins, et autres jacarandas - et de bassins. Devant une fontaine, le sculpteur des sirènes en pierre n’a pas jugé utile de couvrir leurs seins, et les autorités ont laissé faire….
Du 4 au 6 juin 2018, le Fuego se déchaînait, éjectant une colonne de fumée haute de 2 km, et un flux pyroclastique (« nuée ardente ») meurtrier, propulsé à 700 km/h.
Le village de San Miguel Los Lotos, ainsi que des maisons isolées, furent carbonisés, avec un lourd bilan humain (400 morts et disparus).
Nouvelle alerte, cinq mois plus tard, heureusement sans victime humaine : le panache de lave est monté à 500 m, et les cendres « seulement » à 1 km de hauteur.
En tout, pour l’année 2018, cinq épisodes d’un cycle d’éruption violent, supposé clos.
Pendant tout notre séjour, nous avons surveillé, du coin de l’œil, l’aspect du panache encendré au-dessus du Fuego, sentinelle omniprésente…On ne sait jamais !
Quand l’avion a viré sur l’aile, cap sur Salvador, une silhouette sombre a surgi au loin, découpée à contre-jour, dans les lueurs pâles du couchant : un cône, surmonté de la même colonne de fumée, de même taille, à première vue…
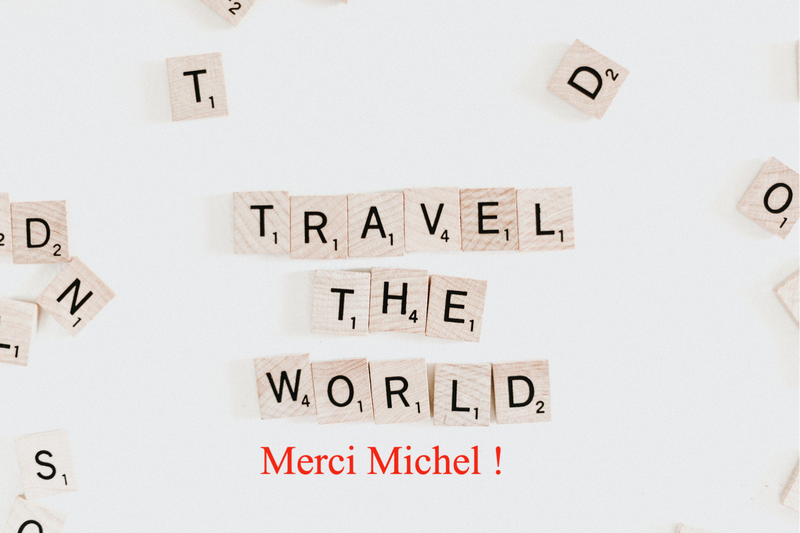
Créez votre propre site internet avec Webador